Le lancement de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) du Genevois français : genèse, enjeux et perspectives
- Alain Mayaud
- il y a 6 jours
- 3 min de lecture
Mercredi 9 juillet dernier, l'association LEX 2050 était représentée par notre conseiller Christoph STUCKI, ancien directeur des Transports Publics Genevois, lors du lancement de l'Autorité organisatrice de la mobilité du Genevois français.
Le lancement officiel de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) du Genevois français au 1er juillet 2025 marque une étape décisive dans la structuration des politiques de transport et de mobilité durable au sein de ce territoire transfrontalier en pleine mutation. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de coopération territoriale engagée dès 2019 sous l’égide du Pôle métropolitain du Genevois français, réunissant plusieurs intercommunalités autour d’enjeux communs de mobilité, de transition écologique et de cohésion territoriale.

1. Une construction progressive et concertée
Le processus de constitution de l’AOM repose sur un travail préparatoire conséquent, amorcé avec l’adoption, en mars 2021, d’une Charte de la mobilité. Ce document-cadre, élaboré de manière partenariale, a été suivi en 2022 par la signature d’un pacte mobilité engageant plusieurs intercommunalités, dont Annemasse Agglo et la Communauté de communes du Genevois. Ce pacte définissait à la fois les objectifs stratégiques et le calendrier de mise en œuvre d’une autorité commune de la mobilité. Il actait ainsi le principe d’une mutualisation volontaire de la compétence mobilité, exercée jusqu’alors de manière disparate sur le territoire.
2. Une gouvernance renouvelée au service de la cohérence territoriale
La décision formelle de création de l’AOM a été entérinée le 26 avril 2024 par le Comité syndical du Pôle métropolitain, qui a modifié ses statuts en conséquence. Ce changement a permis d’instaurer une gouvernance à la carte, fondée sur l’adhésion volontaire des intercommunalités souhaitant transférer leur compétence mobilité. À compter du 1er juillet 2025, le Pôle métropolitain exerce ainsi pleinement la compétence AOM sur les périmètres d’Annemasse Agglo et de la Communauté de communes du Genevois, représentant environ 145 000 habitants.
Ce nouveau cadre institutionnel permet une planification plus intégrée des politiques de transport, en cohérence avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et les exigences de coordination transfrontalière avec le canton de Genève. Il s’agit notamment de renforcer l’intermodalité, de développer l’offre de transport public, et d’encourager les mobilités alternatives (marche, vélo, covoiturage).
3. Premières réalisations et perspectives opérationnelles
Le lancement de l’AOM a déjà donné lieu à des avancées concrètes sur le terrain. À la rentrée 2025, la nouvelle ligne de bus Y11, reliant Saint-Julien-en-Genevois à Annemasse en passant par le parc d’activités d’Archamps, sera mise en service. Cette ligne illustre la capacité nouvelle de l’AOM à concevoir et exploiter une offre de mobilité coordonnée à l’échelle de plusieurs intercommunalités, en lien étroit avec les besoins des usagers et les dynamiques économiques locales.
Par ailleurs, les perspectives de développement de l’AOM incluent une meilleure articulation avec les autorités organisatrices suisses, la mise en œuvre de pôles d’échanges multimodaux, ainsi qu’un élargissement progressif de son périmètre d’action. La question du financement demeure centrale, avec l’objectif de construire un modèle économique pérenne, reposant non seulement sur le versement mobilité mais aussi sur des mécanismes de péréquation et de mutualisation entre les territoires.
4. Conclusion
Le lancement de l’AOM du Genevois français constitue une innovation institutionnelle majeure dans le paysage des mobilités en région transfrontalière. Il illustre la capacité des collectivités locales à coopérer sur un périmètre élargi afin d’apporter des réponses coordonnées aux défis de la mobilité quotidienne, tout en conciliant efficacité opérationnelle, solidarité territoriale et transition écologique. Ce modèle pourrait faire école dans d’autres territoires confrontés à des enjeux analogues de fragmentation institutionnelle et de besoin de cohérence fonctionnelle.



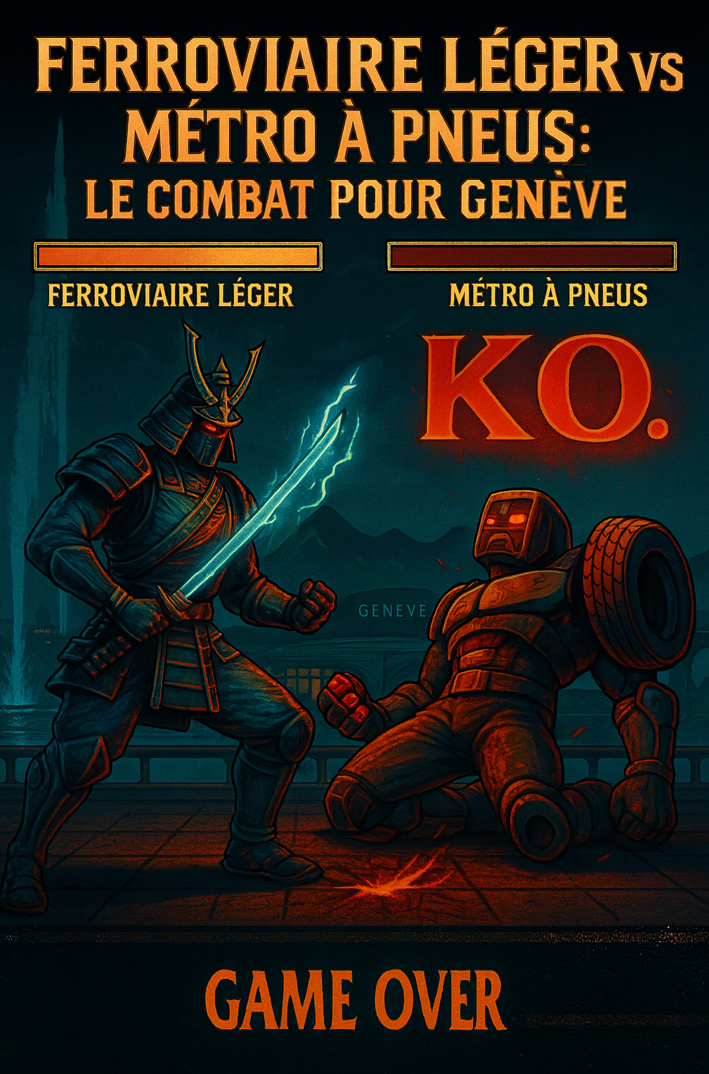
Comentarios